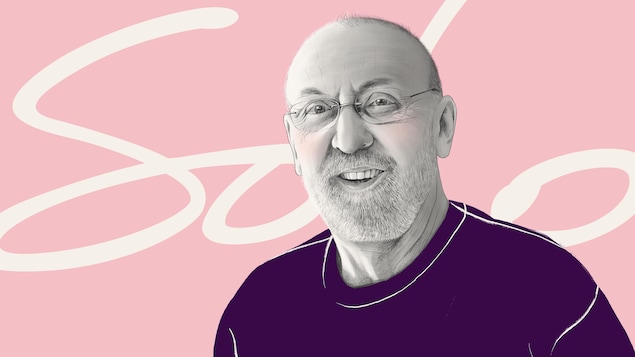Jean-Claude Poitras – Ma poupée
« Je porte un certain mal-être, je ne peux pas le nier. Mais qu’est-ce qui m’a sauvé, moi? »

Signé par Jean-Claude Poitras, pour Solo
L'auteur est créateur de mode.
C'est pour mes 5 ans que mon arrière-grand-mère Marie-Jeanne m’a offert une poupée. Je me revois, si heureux de la tenir.
Celle que je considérais comme ma grand-mère m’avait souvent vu jouer avec la poupée de ma cousine Lise et avait dit : Mais s'il aime ça, mon Dieu, je vais lui en offrir une belle pour sa fête!
Ce dont je me souviens aussi, c’est que quelques jours après s’être aperçu que j’avais reçu ce cadeau, mon père a demandé à voir ma grand-mère.
Même si ces discussions ne se sont pas tenues devant moi, j'ai bien vu, dans les semaines qui ont suivi, que la foutue poupée causait tout un émoi. J’ai donc vite compris que je ferais mieux de me cacher pour jouer avec elle.
Dès que je le pouvais, je m’isolais dans ma chambre pour lui découper des robes, lui faire des jupes, lui inventer toutes sortes de vêtements.
Déjà, presque deux décennies avant mes premiers pas dans le monde de la mode, là, dans ma chambre, à l’abri des regards, j’imaginais, je créais, je concevais des vêtements et des accessoires pour une poupée. Ma poupée.
Caché dans ma chambre, ça pouvait aller. Mais je savais très bien que la simple idée que je passe mon temps à habiller une poupée agaçait vraiment mon père.
Alors, c’était devenu un rituel : dès que j’avais fini de jouer avec elle, je me rendais dans la chambre de ma grand-mère pour la cacher. Je me souviens qu’en utilisant le marchepied, j’étais tout juste assez grand pour m’étirer et la dissimuler là-haut, dans le placard, à côté de l’une des boîtes à chapeaux qui se trouvaient sur la tablette.
À mes yeux d’enfant, elle y était bien camouflée, en sécurité.
J’ai joué comme ça, avec ce cadeau de ma chère grand-mère, jusqu’à ce fameux jour. Je devais avoir 7 ans et demi, 8 ans tout au plus.
Je suis monté sur le marchepied. La poupée avait disparu.
C’est fou, mais je me rappelle très bien n’avoir rien dit, n’avoir posé de question ni à mon père ni à ma grand-mère.
Pas besoin, j’avais tout compris : mon père l’avait finalement jetée aux ordures, comme il l’avait toujours souhaité. C’était limpide maintenant. Il était temps, à mon âge, que je passe à autre chose.
Ce jour-là, je n’ai rien dit.
En fait, je me suis refermé comme une huître.
J’ai toujours su que j’étais différent et ma grand-mère l’était aussi. Elle m’appelait d’ailleurs son oiseau rare. C’est sans doute pourquoi nous étions si proches, collés l’un sur l’autre, en pleine complicité.
J’ai passé mes étés avec elle, au chalet à Saint-Placide. Mes parents et mes frères arrivaient le vendredi soir et repartaient le dimanche, mais moi, j’y restais toute la semaine.
Ma grand-mère m’a tout appris. On travaillait dans le potager. On allait à la pêche. On cueillait des framboises sauvages. Elle me faisait la lecture.
Elle me faisait aussi participer à tout. Par exemple, elle prenait des contrats des concessionnaires du Parc Belmont, pour qui elle s’occupait de laver, sécher et repasser les costumes et les uniformes. Je me souviens de l’entendre m’appeler pour que je vienne l’aider à étendre chacune des pièces sur l’une de ses cinq cordes à linge.
L’odeur de ce qu’on appelait, à l’époque, le bleu à laver
, qui enveloppait la maison, me revient immédiatement à l’esprit. L’odeur des vêtements propres.
L'automne et l’hiver, mes tantes se rassemblaient souvent autour de ma grand-mère à la maison pour travailler et jaser. Je voyais alors toutes ces femmes tricoter, crocheter, recycler des vêtements. Au fond, je me retrouvais avec, autour de moi, une sorte de petit atelier de haute couture, avec toutes ces petites mains qui, dirigées par ma grand-mère, créaient, réparaient, rapiéçaient.
Ces moments ne sont pas étrangers, j’en suis sûr, au fait que dans ma carrière de créateur de mode, les heures les plus heureuses que j’ai pu vivre ont justement été celles où je me suis retrouvé à travailler avec mes couturières, mes petites mains
, dans la solitude de la création.
Déjà quand j'étais tout petit, ma grand-mère me faisait participer à tout ça. J’ai toujours senti et su, au plus profond de moi, que cette femme m’adorait.
C’est d’ailleurs elle qui m’a mis au monde, comme elle était sage-femme. Le soir même de ma naissance, je pleurais à pleins poumons dans mon petit lit, à un point tel que mes parents ne savaient plus quoi faire. Devant ce constat d’impuissance, ma grand-mère m’a simplement pris et amené dans son lit. Il paraît que je me suis immédiatement apaisé.
Pendant des années, j’ai suivi le même rituel : je m’endormais dans ma chambre, puis, plus tard, je me levais discrètement pour aller finir la nuit dans le lit de ma grand-mère.
C’était instinctif, chez moi, d’aller me réfugier auprès d’elle.
Je me souviens d’ailleurs d’avoir surpris une conversation entre mes parents et quelques oncles et tantes, qui discutaient dans le salon. Me pensant endormi, mon père avait dit : C’est sûr que la grand-mère, elle nous a volé Jean-Claude, mais au moins, on a Daniel (mon frère).
Encore aujourd’hui, c’est limpide à mes yeux : j’étais l’enfant de ma grand-mère, beaucoup plus que celui de mes parents.
Car non seulement cette femme a vite vu ma différence et l’a acceptée, mais elle l’a même encouragée. Avec le recul, aujourd’hui, je réalise à quel point elle était, déjà à l’époque, une femme libérée et avant-gardiste dans sa façon de penser.
Avec les années, mes parents et moi nous sommes réconciliés. J’ai souffert par la suite, notamment à l’adolescence, mais je peux dire que j’ai eu une enfance heureuse, dans ce cocon, avec mes parents, mes frères, mes tantes et ma grand-mère adorée.
Elle est décédée en octobre 1969. Elle avait 79 ans, moi 20.
Je passais mes étés avec ma grand-mère, et le reste de l’année, je vivais dans le nord de Montréal. Dans le Cartierville de mon enfance, j’avais deux grands amis : Mireille et Raymond. Nous étions nés la même année, à quelques jours d'intervalle. On nous appelait les trois inséparables
.
J’étais heureux avec eux parce qu’ils embarquaient dans mes jeux, dans mes désirs de les costumer, dans mon imaginaire, dans tous ces trucs que les autres enfants n’acceptaient pas.
Je pense que sans pouvoir encore l’articuler, nous étions déjà conscients de notre marginalité. Nos centres d’intérêt étaient très différents de ceux des autres enfants de notre âge.
À l'école primaire, j’ai tout fait avec ces deux êtres que j’aimais éperdument. Mais les années ont passé et, inévitablement, l’entrée au secondaire et le déménagement de mes parents à Sainte-Dorothée nous ont séparés. Raymond est allé au Mont-Saint-Louis. Je n’ai jamais su à quelle école Mireille s’était retrouvée.
Moi, j’ai abouti au Collège Saint-Laurent.
La période qui a suivi, celle du cours classique, de la cafétéria infecte du collège et des obligatoires sports de gars
, a sans aucun doute été la pire de ma vie. Pendant mes cinq années là-bas, j’ai toujours été le dernier arrivé et le premier parti. J’ai traversé ces années comme une ombre, en écrivant, écrivant et écrivant encore dans mon journal personnel, dans la solitude la plus totale.
Je me cherchais. Je ne savais pas qui j’étais.
Puis, un jour, mon professeur de physique – une matière qui me puait au nez – a découvert qu’à l’intérieur de mon cahier se cachait une multitude de croquis de sacs à main, de chapeaux, de jupes, de robes.
Partout, ce n’était que ça : des dessins, des esquisses, des ébauches de vêtements ou d’accessoires de mode.
Mais au lieu de se fâcher, il en a parlé à son collègue, professeur de latin, celui-là.
Les deux ont alors convaincu mes parents de m’envoyer passer un test d’orientation dans une entreprise spécialisée en la matière.
Ce samedi allait changer ma vie.
L’exercice s’étalait sur la journée entière, de 8 h à 17 h, dans ce qui s’appelait à l'époque l’Institut d’orientation professionnelle. Mes parents sont venus m’y déposer. C’était sur la rue Saint-Hubert, juste au nord de la rue Sherbrooke.
J’ai alors passé test par-dessus test, sans arrêt. Puis vinrent, en fin de journée, les résultats.
Je revois ma mère et mon père assis dans le bureau du directeur, qui rendait son verdict.
— C’est sûr que Jean-Claude est un artiste dans l’âme, a-t-il immédiatement établi. Il est sensible à l'art en général. On pourrait le voir en décoration intérieure, mais on dirait que la mode…
En entendant ce mot, je me suis levé d’un bond, sans réfléchir, comme par simple réflexe.
— C’est ça!
Enfin, quelqu’un l’avait dit, l’avait nommé pour moi.
Tout jeune, j’avais eu cette poupée, que j'habillais déjà. J’avais costumé mes deux amis pendant tout le primaire. J’avais rempli mes cahiers de sciences, au secondaire, avec des croquis de vêtements et d’accessoires.
Toutes ces années à me chercher, à me poser des questions, à me sentir au mauvais endroit, à être si malheureux jour après jour…
La mode. C’était soudainement si évident.
Mon père, secoué, s’est levé aussi. Ça existe, ce métier-là? Il y a des écoles pour ça?
Il en existait deux : l’École Cotnoir-Capponi, privée, et l’École des métiers commerciaux – un nom horrible –, publique.
Cette fois, je dois dire que mon père m’a impressionné. Quelques jours plus tard, malgré le choc causé par ce choix dont il ne savait que faire, il a pris le téléphone et a eu le culot d’appeler le couturier le plus connu de l’époque, qui avait sa boutique sur la rue Crescent : Michel Robichaud.
Ce dernier lui a alors conseillé l’École des métiers commerciaux, où il avait lui-même étudié, tout comme Léo Chevalier et Marielle Fleury.
C’est là, à cette école, que la chenille que j’étais allait se transformer en papillon.
Enfin.
Les années ont encore passé et j’ai commencé à travailler et à devenir un peu connu. On parlait parfois de moi dans les journaux et les revues.
Chacun à sa façon, Raymond et Mireille ont tenté de reprendre contact avec moi. Ils avaient lu sur moi ou m’avaient vu à la télé, ils souhaitaient maintenant me féliciter et espéraient bien qu’on se revoie après toutes ces années sans nouvelles.
Je me souviens d’être au téléphone avec Mireille et de me dire, intérieurement, Mon Dieu, si je la revois après tout ce temps… Et si elle a évolué dans un sens, et moi dans l’autre? Et si c’était la même chose avec Raymond?
Je craignais d’être déçu. Pas d’eux, mais de ce que notre rapport serait devenu. Ces années de jeunesse passées avec eux étaient tellement précieuses pour moi que je voulais absolument les garder intactes.
Je n’ai, finalement, jamais saisi la main qu’ils me tendaient, et pour ça, je m’en suis toujours voulu.
Plus tard, ma mère a croisé celle de Raymond, qui lui a annoncé la triste nouvelle : Raymond s’était suicidé.
La même année, j’apprenais que Mireille, elle aussi, s’était donné la mort.
Ils devaient avoir 22 ou 23 ans.
Un jour de l’été 2018, j’assistais à une fête célébrant l’anniversaire de mariage d’un oncle et d’une tante. Plusieurs membres de la famille étaient présents, dont l’une de mes tantes dont j’ai aussi été très proche dans ma jeunesse : Aline. Déjà d’un âge avancé, elle était atteinte d’un cancer et sa fragilité sautait aux yeux.
Assez tôt dans la soirée, tante Aline a signalé être prête à rentrer, mais elle s’est ensuite adressée à moi.
Jean-Claude, viens avec moi, a-t-elle dit. J’ai quelque chose à te remettre. J’aurais pu te la donner bien avant, mais je pense que le moment est venu.
Là, en retrait au fond de la salle, tante Aline m’a tendu une boîte rectangulaire.
Je l'ai ouverte.
Ma poupée.
J’étais estomaqué. J’avais peine à croire que je tenais véritablement cet objet dans mes mains, toutes ces années plus tard.
Tante Aline m’a alors dit : Jean-Claude, ça t'appartient. C'est à toi. Et puis, je veux que tu saches l'histoire.
Elle m’a alors expliqué que, certaine que mon père s’apprêtait à la jeter aux ordures, ma grand-mère lui avait confié la poupée. Toi, Aline, aurait-elle dit, tu connais Jean-Claude, tu l'aimes tellement, il t'aime tellement… Toi, tu vas la protéger.
Je suis rentré chez moi avec la poupée dans sa boîte. Cette nuit-là, je n'ai fait que des rêves avec ma grand-mère. Tous mes souvenirs, toute mon enfance me revenaient en tête.
Tenir à nouveau cette poupée m’a ramené à cette période heureuse, alors que j’étais bercé par cette grand-mère qui m’a tout donné, tout appris, et qui m’a accueilli comme j’étais, dès le départ. À cette espèce de fissure avec mes parents, aussi.
Ça m’a également ramené à la notion de différence et à mes deux amis d’enfance. À ces êtres que j’ai tant aimés et qui se sont donné la mort à quelques mois d‘intervalle.
Leur différence, comment Mireille et Raymond l’avaient-ils vécue après que nos chemins se furent séparés au début de l’adolescence, pour qu’ils décident d’en finir ainsi?
Je porte moi aussi un certain mal-être, je ne peux pas le nier. Une espèce de mélancolie, de nostalgie. Je suis toujours entre l’ombre et la lumière.
Mais qu’est-ce qui m’a sauvé, moi?
Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que je pense d’abord et avant tout être un homme libre, et je suis content de ne pas avoir cherché, dans ma vie, à être autre chose.
Ça, je ne l’ai pas réalisé pendant des années, mais je m’aperçois aujourd’hui que c’est une force. Parce que j’en ai croisé, pendant l’adolescence, des jeunes qui faisaient tout pour rentrer dans le rang. Mais non, pas moi. Je ne fais pas ça, je ne pense pas comme ça.
J’ai l’impression, donc, que soit la différence nous casse et on a des regrets tôt ou tard, soit elle forge notre caractère et notre identité. Dans mon cas, je crois que c’est précisément ma différence qui a donné naissance à mon originalité, ma créativité, ma façon d’oser faire les choses d’une autre manière. Ma façon d’être un oiseau rare.
J’ai maintenant ma poupée pour, chaque jour, me le rappeler.
Propos recueillis par François Foisy
Illustration d'entête par Sophie Leclerc à partir d'une photo de Denis Wong